Intervenant(s)

Stéphane JAMAIN
Chercheur, responsable du groupe génomique, Institut Mondor de Recherche Biomédicale - Créteil
Session "Remplacement des modèles animaux et produits d’origine animale"
Replay des journées françaises des 3R - 22.11.24

Stéphane JAMAIN
Chercheur, responsable du groupe génomique, Institut Mondor de Recherche Biomédicale - Créteil
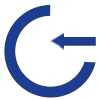 Retour
Retour
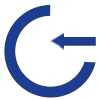 Retour
Retour
Les modèles de souris sont un standard pour comprendre les anomalies du développement cérébral qui sous-tendent les troubles psychiatriques, mais la modélisation des modifications génétiques et leurs conséquences sur les stades précoces du développement cérébral reste un véritable défi. Nous avons récemment montré une fréquence plus élevée de mutations rares dans le gène SMARCC2 chez des personnes atteintes de troubles bipolaires. Ce gène, également associé à d’autres troubles du neurodéveloppement, code pour l’un des quinze partenaires du complexe de remodelage de la chromatine SWI/SNF et joue un rôle critique dans le développement du cerveau, ce qui suggère que le trouble bipolaire pourrait résulter d’anomalies neurodéveloppementales. Des études antérieures sur des modèles animaux ont suggéré que SMARCC2 jouerait un rôle crucial dans la corticogenèse et que des changements d’acides aminés dans cette protéine pourraient entraîner des anomalies cérébrales. Cependant, l’étude des premiers stades du développement du cerveau chez les mammifères soulève des questions éthiques. Afin de remplacer l’utilisation de modèles murins pour étudier les premiers stades du développement cérébral, nous proposons de développer des cultures de neurones et d’organoïdes cérébraux dérivés de cellules souches pluripotentes humaines induites. La formation de neurones et la différenciation des organoïdes sont étudiées dans des cellules dans lesquelles des mutations associées à la maladie ont été introduites. Le développement de tels modèles devrait aider à comprendre les mécanismes physiopathologiques affectés par les mutations de SMARCC2 et à remplacer les modèles murins par des cultures organoïdes en 3D. Ces modèles cellulaires pourraient également servir d’outil pour tester l’efficacité de nouveaux médicaments.

